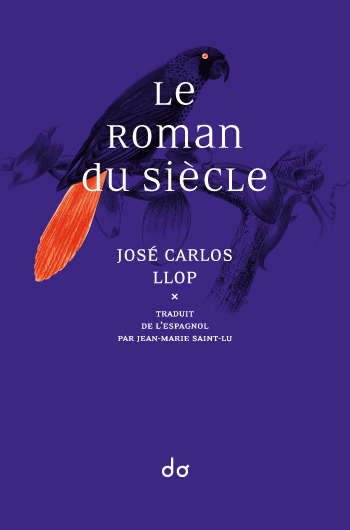Aller au contenu
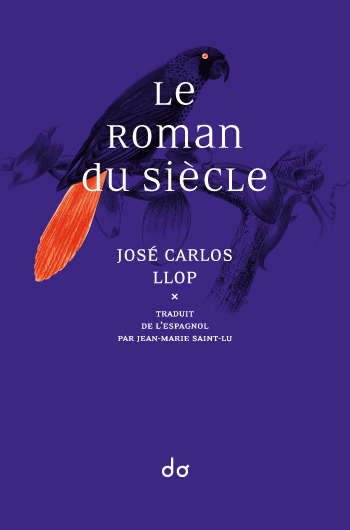
Le Roman du siècle
Titre original : La novela del siglo
Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu
152 pages / 17 € / Format 13 x 20 cm / ISBN 979-10-95434-32-0
Paru le 9 avril 2021

×
〈 Le livre 〉
Le délire d’un espion convaincu que son travail refusé aurait changé le sens de l’Histoire ; l’occasion trahie d’une seconde vie dans une colonie africaine ; les équivoques relations de pouvoir dans le sexe ; les malédictions de l’Europe ; le remplacement de l’amour par la botanique exotique ; une restauratrice d’œuvres d’art qui évoque sa passion lesbienne ; l’art comme métaphore de l’échec amoureux ; Dickens et Jivago dans un nouveau conte de Noël ; une nouvelle qui est toutes les nouvelles publiées dans le monde…
Connu en France comme romancier, José Carlos Llop est aussi poète et ses récits remplissent la double fonction de faire naître le mystère et de dessiner la carte qui mène du poème au roman. Dans ces pages se déploient quelques visages du XXesiècle qui nous montrent les différentes façons d’être seul.
Il s’y cache un arbre généalogique où figurent Poe et Borges d’un côté, Conrad et Tchekhov de l’autre, repères magistraux qui constituent le terreau du Roman du siècle.
José Carlos Llop est un maître des atmosphères sous lesquelles se cache l’inquiétante impression que rien n’arrive jamais et que cependant tout arrive.
×
〈 Extrait 〉
« Notre maison était située à l’orée du monde. Je suis né en 1950, alors qu’on entendait de nouveau rugir les sportifs dans les rues de Londres et qu’aux terrasses de Paris personne n’aurait dit que l’avant-veille encore on y parlait allemand. Il y a une tendance à prendre l’Europe trop au sérieux, alors que l’Europe n’est compréhensible que depuis l’humour. L’Europe a un sens de l’humour trop macabre pour qu’on ne la prenne pas à la rigolade. C’était quelque chose qu’on savait très bien dans ma famille. Dans ma famille, on riait de tout. J’ai toujours regretté le manque d’une petite dose de mélancolie dans ma famille, je ne sais pas, cette tristesse qui envahit certains êtres au printemps ou la noirceur que distille parfois l’automne. Mais pas question. Même la mort ne causait pas la moindre peine dans ma famille. Tout était matière à plaisanterie et cette prédisposition au sarcasme faisait naître en moi l’étrange sensation de vivre dans une maison sans toit. Une maison située à l’orée du monde, exposée aux quatre vents et aux orages, d’où on voyait la vie comme un cirque délabré et impossible.
Mais ma vie tout entière a été un cirque. Toutes mes vies ont été un cirque, devrais-je dire. Parce que j’en ai eu beaucoup. Et chacune en soi, chacune par elle-même, a eu la même valeur que celle de n’importe quel autre homme, mais toutes ensemble elles ne sont qu’un cirque macabre, car est macabre la vie de celui qui a eu beaucoup de vies et qui sait que sa vie est un spectacle de cirque, entre la tension, l’émotion et le rire. Ma famille avait opté pour le rire. Moi, j’ai hérité de la tension. L’émotion est un sentiment que je ne connais pas. Tout comme l’ignore ma famille.
Inutile de dire que ces choses ne me faisaient pas rire du tout. Le rire en soi ne me faisait pas rire, tant j’en étais las. Je me rappelle une nuit de brouillard au cours de laquelle une clameur épouvantable assiégeait notre maison. Le soir venu, mon grand-père avait fermé persiennes et volets et j’observais la rue par une lucarne du grenier. Le brouillard se promenait sur le pavé de la rue comme un gigantesque boa constrictor et les réverbères semblaient enveloppés de gaz. Ma mère était à la cuisine, à préparer le dîner ave mes tantes. Mes cousins jouaient au billard au sous-sol. Mon père était au journal et mon oncle en voyage. Mon oncle voyageait beaucoup : il était couturier et présentait ses collections à Madrid et Barcelone, à Rome et à Berlin. Le rêve de mon oncle était Paris. Cette nuit-là, mon oncle rêvait dans un hôtel de Paris. »
×
〈 À propos 〉
« La mémoire et ses récits, l’Histoire à l’ombre de ses fantômes, à la lumière de ses destructrices fascinations. Le Roman du siècle, du XXe, ses guerres et ses salauds recyclés, est une multitude d’histoires, des nouvelles plurielles, proches, où se dessinent la perte et la peur. Entre deux très beaux textes, qui soulignent les reviviscences cauchemardesques dont se constitue ce livre, José Carlos Llop signe neuf nouvelles où la culpabilité, l’oubli et la hantise sont les signes de ce siècle enfui.
Un écrivain accompli se révèle sans doute jamais mieux que dans ces textes brefs, dans la manière dont il parvient à les articuler pour en faire davantage qu’un recueil de nouvelles. José Carlos Llop interroge, met en pratique tout aussi bien, la platitude de l’inscription biographique de l’auteur dans son texte. Dans Solstice, il en livrait la version en apparence lumineuse : d’insulaires souvenirs enfantins. Ici, nous serions plutôt dans le maléfice, le mensonge. Peut-être ne devrait-on jamais reconnaître l’auteur que dans ce type de truqueuses déclarations : « Je compris alors que tout ce que j’avais pris pour ma vie n’était que le rêve d’un fantôme. » Le Mal, la souveraine hantise du vieux vingtième siècle. Sans doute parce que nous n’avons pas pris pleine conscience des soubresauts de celui qui anime et aimante le nôtre. On pourrait alors rapprocher Le Roman du siècle du recueil de nouvelles de Jaume Cabré Quand arrive la pénombre. On rentrerait alors dans la singularité de l’œuvre de Llop : les rapprochements et autres appropriations y sont la seule manière de dire ce qui échappe.
Pour le dire avec des mots un rien trop prétentieux : ce que tente de saisir José Carlos Llop est le transpersonnel de l’Histoire, non tant sa mémoire collective que ses manières de nous revenir dans des récits aux structures connues, répétitives comme des hantises. Beaucoup de ses nouvelles se dotent d’un narrateur à la première personne, toutes se confrontent à un passé qui ne passe pas. Si le vingtième siècle était un roman ses protagonistes seraient des opportunistes, sympathisants fascistes par sens des affaires, goût de la domination et de la manipulation. Le lecteur aura une curieuse impression de ressemblance entre tous les personnages de ce Roman du siècle : des hommes perdus, travaillant plus ou moins pour des services secrets, guettant la reconnaissance, subissant une fascination dont ils ne peuvent se déprendre. Il se sentira pris dans un redoutable dispositif narratif. José Carlos Llop signe cependant des nouvelles indépendantes, des histoires qui suffisent à créer leur propre fascination. Le siècle n’est – pas plus que n’importe quel autre – celui du Mal mais plutôt de sa mise en récit, de la fascination qu’il suscite ainsi. Être une éponge à souvenir, donner forme aux limbes, être un voyeur impénitent : telles sont les formes données aux désirs de l’écrivain. José Carlos Llop leur donne leur plus haute expression. Nous aurons le narrateur de la « Suite 501 » qui s’invente espion, écrit des versions de ce qui aurait pu se passer et qui, finit, sans que personne ne le reconnaisse par advenir, nous avons des amours tropicaux qui reviennent hanter comme autant de coupables rêves de fortunes. Nous aurons aussi de ces jeux de miroirs et de fascination comme inversion de la domination qui dans, « La joueuse de tennis », rappelle vaguement – comme un fantôme en rappelle un autre – les héroïnes des nouvelles de Javier Marias.
L’Histoire est un mensonge collectif, il n’appartient jamais tout à fait à celui qui les débite, la fiction serait sa vérité. Ainsi, Le Roman du siècle se referme, chant du cygne autant que de baleines, sur ce qui constitue la matière même de ces récits : des rêves hallucinés d’une mémoire qui appartient à peine à un narrateur à moitié fou, amnésique peut-être, affabulateur sans le moindre doute. Une histoire, disait-on, c’est une fille et un flingue. La place du père, peut-être. Pour José Carlos Llop c’est des mateurs et des fantômes. L’auteur s’essaye même à lui offrir quelques incarnations plus contemporaines. Son air désabusé, son dédain amusé pour les visages qui se reflètent sur les téléphones, soulignent quand même ce besoin d’amour, cette nécessité d’être vu qui au fond caractérise ceux qui se cachent derrière leurs pulsions scopiques. J’aime aussi l’idée que l’interprétation intertextuelle soit peut-être une illusion, Le Roman du siècle se serait des fragments d’histoire, des récits souvent horribles que l’on prend plaisir à écouter. »
La viduité →
×
« Ce n’est pas un roman. Contrairement à ce que son titre indique, c’est un recueil de nouvelles, et sa thématique n’est pas assez large – loin de là – pour couvrir un siècle entier.
La plupart des textes renvoient plus ou moins explicitement au franquisme et au nazisme, et l’on y croise un nombre d’Allemands qui pourrait ébaubir le lecteur qui ignorerait leur omniprésence à Majorque (où vit l’auteur), île surnommée « le dix-septième Land ».
Si la thématique n’est pas des plus variées, la forme des nouvelles offre une diversité bienvenue : on pourrait dire qu’il y en a pour tous les goûts. Certaines sont longues, d’autres tiennent presque du poème en prose ou de la série d’histoires minuscules.
Dans la première catégorie, j’ai préféré « Passeport diplomatique », où il est question d’un Français, ancien agent nazi qui finira sa vie en Espagne, et d’un Espagnol, fils prodigue issu d’une famille glorieuse, qui se sont connus et liés en Guinée, avant que le premier ne décide de priver le second de sa femme. La manière ingénieuse dont ces trois destins s’entrelacent a de quoi vous captiver.
Moins longue, la nouvelle intitulée « La Joueuse de tennis » séduit d’abord par son atmosphère oppressante, très réussie, puis par une révélation complètement inattendue et pas moins convaincante.
Mais ce sont les textes les plus brefs qui me semblent les plus réussis du volume : « L’art ou la vie », dont l’essentiel repose sur une description de tableau ou « L’esprit de Noël », où il est question du réveillon solitaire d’un homme (qui se souvient des années où il avait une femme et des enfants), et surtout « Le chant des baleines », dont le narrateur – qu’on peut croire fou ou simplement imaginatif – enchaîne trente-trois histoires minuscules, changeant d’identité dans chacune ou presque, et traversant ainsi divers espace-temps.
L’on y trouve des passages d’une poésie presque surréaliste, comme celui-ci : « Les monarchies étaient des coffres mis à l’écart dans un grenier poussiéreux et délabré, et les femmes de Madrid avaient un fume-cigarettes en nacre et se teignaient les cheveux en blond platine. Ma voiture était couleur cerise mûre, comme leurs lèvres. Dans les vitrines des boutiques, il y avait des visons, des blocs de glace et des yeux de verre » (p. 120).
Les amateurs des livres de José Carlos Llop publiés précédemment en français seront certainement ravis de lire ce recueil.
Les lecteurs qui ne connaissent pas encore cet auteur y trouveront sans doute ce qu’il faut pour être mis en appétit. »
Le littéraire →
×

Le Figaro littéraire
×

Sud Ouest dimanche
×
« Cet étrange recueil ambivalent, métaphorique et mystérieux, nous embarque dans un voyage en écriture surprenant mais addictif qui nous captive et nous tient en suspension jusqu’au dernier mot. » → lire l’intégralité de l’article
encres-vagabondes.com
×